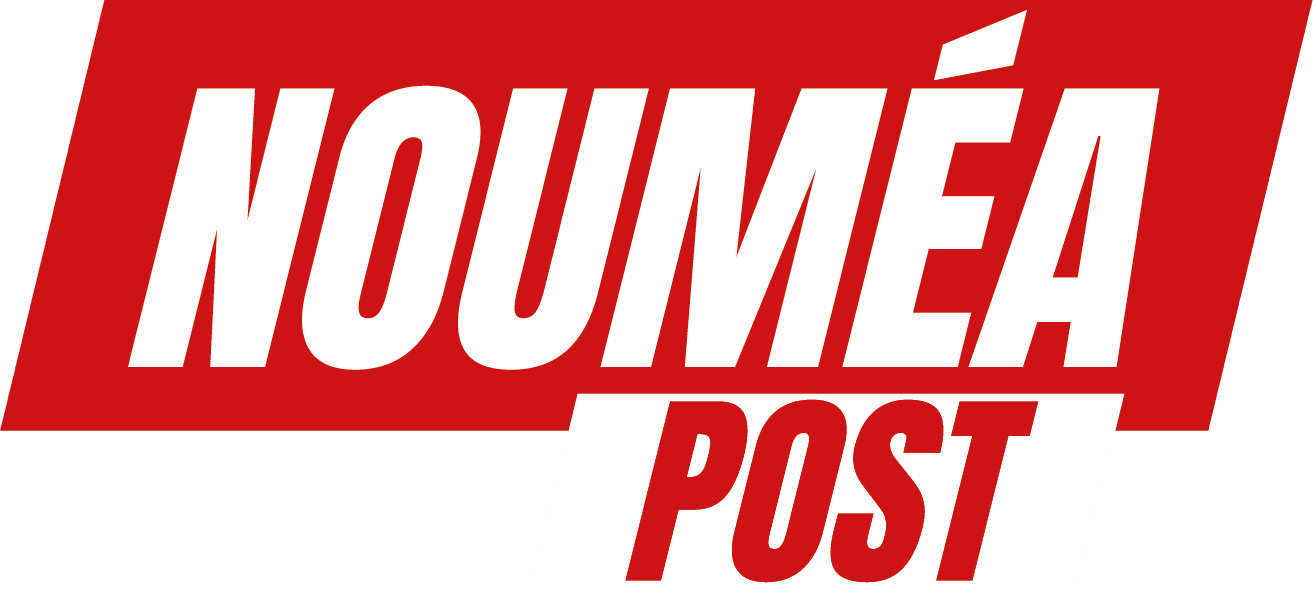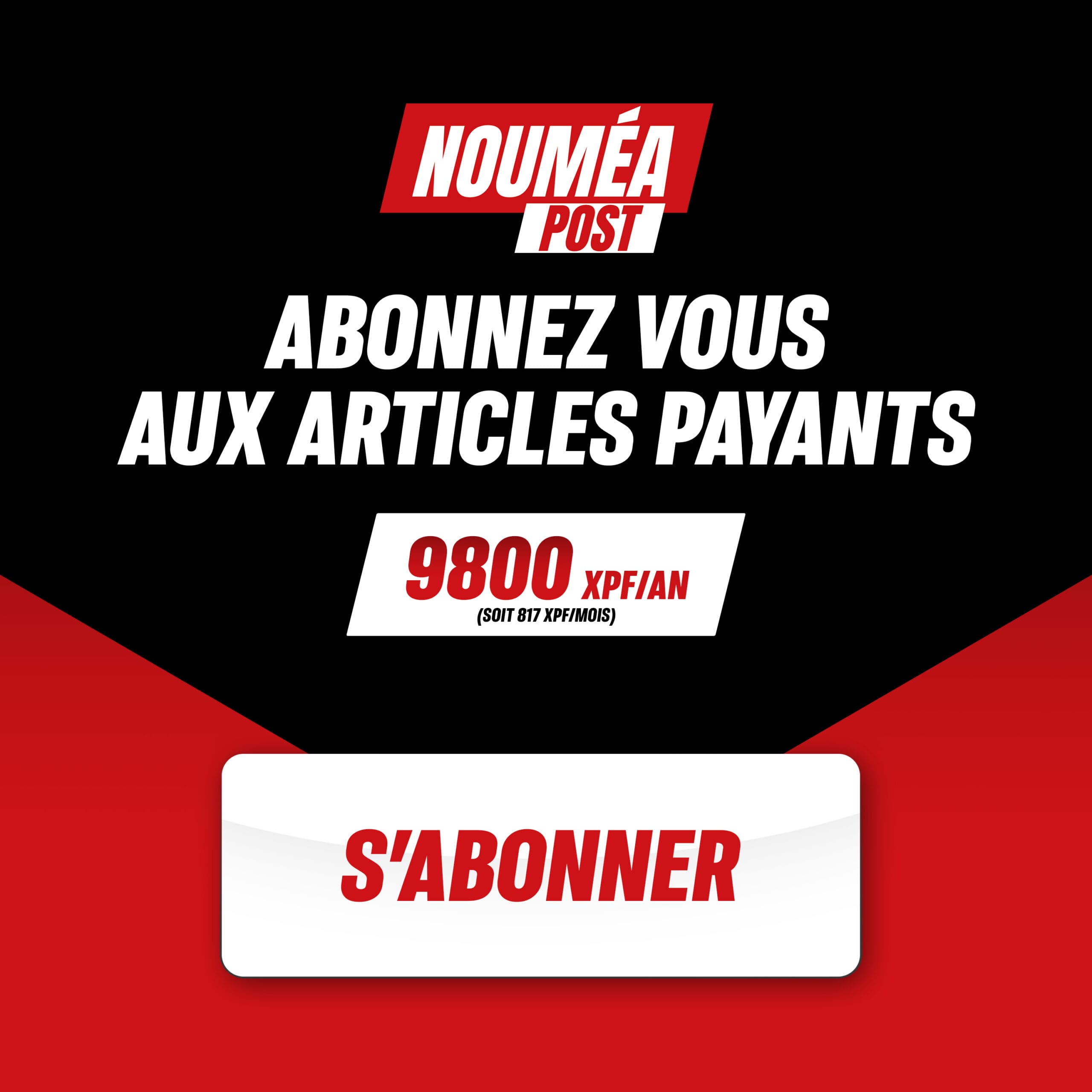Les Accords de Matignon ont ramené la paix en Nouvelle-Calédonie, après 6 mois de guerre civile et 3 ans de troubles et de violence. De ce point de vue, ce fut un succès. Les accords Oudinot ont créé, pour le territoire et la République, un statut d’autonomie à nul autre pareil, salué comme une novation juridique. Les Accords de Nouméa ont prolongé et accentué cette novation. Nouveaux succès. En revanche, l’objectif du « destin commun » entre deux grandes communautés politiques est un fiasco d’autant plus grand que le referendum du 4 novembre confirme un clivage ethnique. C’est un échec.
UNE AMBITION DÉMESURÉE
Les fameux « Accords » ont affiché une ambition démesurée, « sacralisée » dans le préambule habile de 1998 : construire une communauté de destin entre deux populations défendant chacune un objectif inconciliable : l’indépendance pour l’une, le maintien de l’appartenance à la République pour l’autre.
Pour cela, une architecture et un projet exceptionnels ont été bâtis dès 1988 dans le consensus entre l’Etat et les deux « adversaires-partenaires ».
DES INNOVATIONS POUR DÉSAMORCER LES ANTAGONISMES
Pour désamorcer les antagonismes, le pouvoir politique a été partagé en tordant le cou aux règles démocratiques habituelles : une structure fédérale interne avec des provinces découpées sur mesure et dotées de compétences considérables, un Congrès aux pouvoirs d’un parlement, une répartition inégale des richesses avec le principe novateur du rééquilibrage, une formation dans le principe d’une discrimination positive en faveur des kanak.
La reconnaissance identitaire du « peuple premier » est devenue, en 1998, une obligation légale et morale.
DES MILLIARDS DÉVERSÉS
L’Etat a déversé des milliards en faveur des deux provinces indépendantistes, et a soutenu, par des subsides publics, l’industrialisation tant attendue du nord.
Ces principales mesures ont été complétées par une pléthore d’autres dispositions, toutes à vocation de paix, et d’une réduction des inégalités entre les trois provinces qui est une réalité .
L’ÉCHEC CUISANT DU « DESTIN COMMUN »
Mais bien au delà, les « Accords » visaient à rassembler les deux camps antagonistes dans un concept de « destin commun », claironné à longueur de mois pendant une trentaine d’année. C’est ce qui importe pour la paix durable de la communauté calédonienne.
Or, après ces trente années, le résultat est terrifiant : les équilibres politiques, et donc les antagonismes politiques, en proportion, n’ont pas varié d’un iota ! Pire, le vote du 4 novembre est quasiment ethnique -« identitaire », pourrait-on dire pudiquement- : les Kanak d’un côté, les « non Kanak » de l’autre. « Peuple kanak » versus Caldiens.
Dans la communauté calédonienne d’avant les événements, il existait une proportion sensible, minoritaire mais réelle, de Kanak favorables aux partis dits « loyalistes ». Quasiment disparue …
Il n’y aura donc pas de « destin commun », terrible constat.
La réalité calédonienne, par delà les incantations du politiquement correct, s’appelle coexistence pacifique. Obligée, pour l’instant.
UN CONCEPT INSTITUTIONNEL DÉPASSÉ
Les positions inconciliables s’étant confirmées après 30 années, le concept même des institutions issues des « Accords » est désormais dépassé par cet échec cuisant. Même revisitée, améliorée, étendue à davantage d’autonomie, l’architecture juridique construite en 1988 puis en 1998 ne peut répondre à la situation créée par le referendum du 4 novembre 2018. Ce ne sont pas de retouches ni de simples novations dont la Calédonie a désormais besoin, mais d’une vraie « révolution » juridique à imaginer.
ET APRÈS ?
Quoi qu’il advienne, c’est vrai qu’il sera sage -et impératif- de revenir aux affres de la quasi-faillite de l’économie, des comptes sociaux et de la vie chère. Ces difficultés représentent le quotidien d’une majorité de Calédoniens. De ce point de vue, le Président de la République et le Premier ministre parlent d’or.
L’insécurité grandissante vient se rajouter à ces tourments.
Quant aux deux autres referendum, inscrits par ceux-la mêmes qui ont signé les Accords de Nouméa, ils vont probablement être organisés.
Mais après ?
JC Gaby Briault