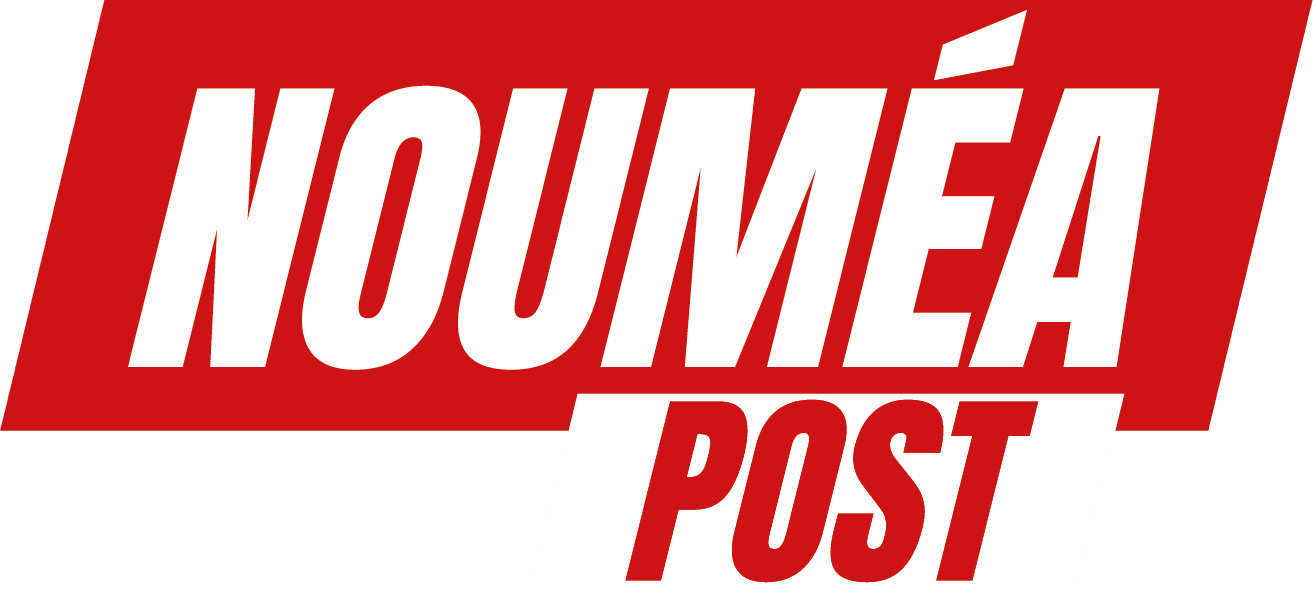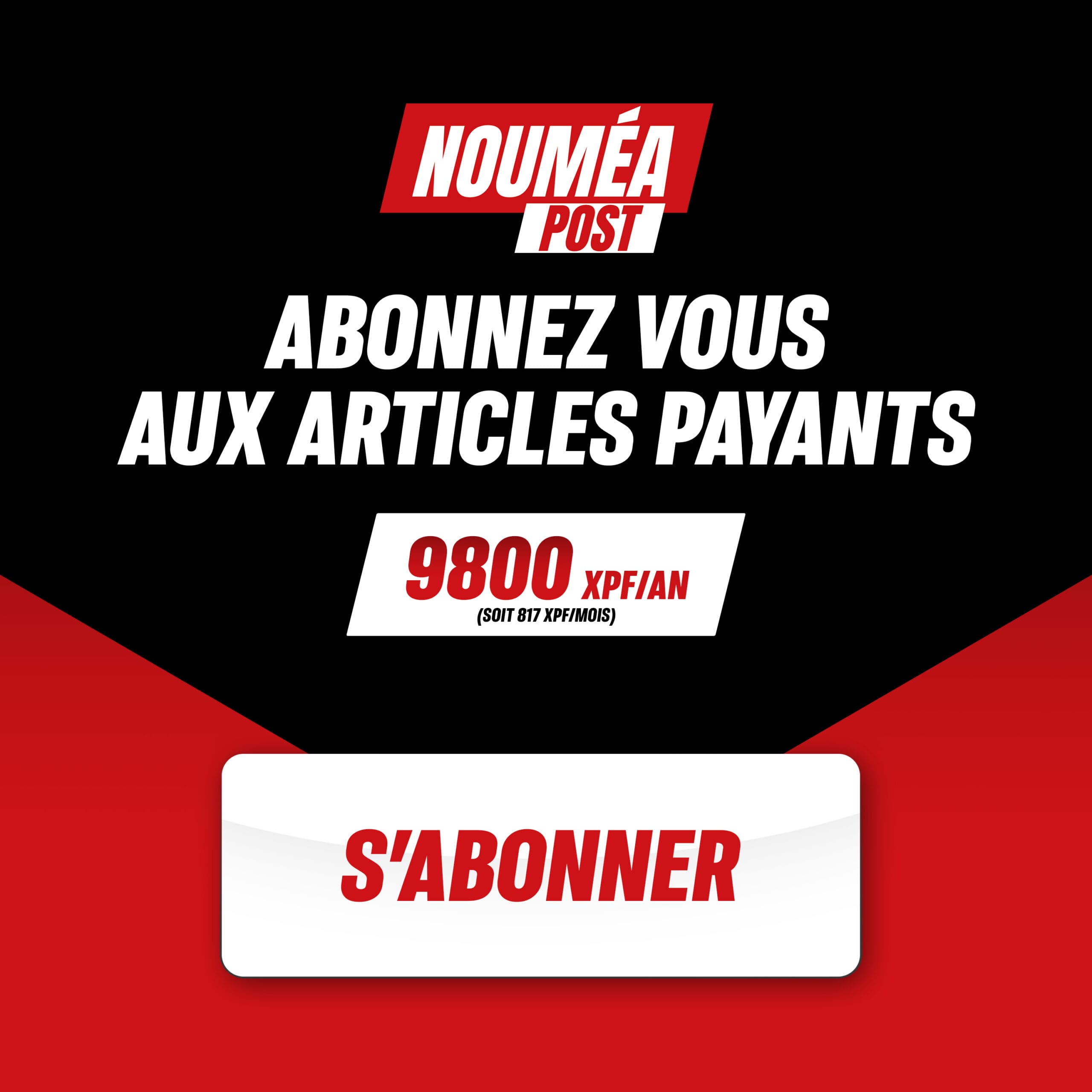La Nouvelle-Calédonie n’est pas un département français. En août 1988, après que son statut ait été mis au point lors des Accords dits Oudinot, elle est devenue, par voie référendaire en novembre de la même année, « un territoire fédéral » constitué de trois provinces. En 1998, par la grâce de l’Accord de Nouméa, le territoire a été érigé en collectivité la plus autonome de la République par un statut qui se rapproche de l’indépendance association … sans l’indépendance. Elle est dotée d’un parlement, d’un exécutif, gère l’ensemble des compétences qui relèvent de la gestion interne. Depuis l’enseignement jusqu’au droit du travail, en passant par la fiscalité, l’économie et le domaine minier. L’État y exerce les compétences régaliennes et admet même une sorte de partage en acceptant la présence de « délégués » de la Nouvelle-Calédonie dans les ambassades régionales. Sans plus, sans moins.
En clair, la France n’a pas ici les mêmes devoirs que dans les départements d’Outre-mer, notamment en matière de finances publiques, d’économie ou de fiscalité. La Nouvelle-Calédonie, qui a voulu exercer des compétences pareilles à nulle autre collectivité, est également face à ses responsabilités.
Le Ruamm en déséquilibre ? C’est sa responsabilité. Des ressources financières et fiscales insuffisantes ? C’est sa responsabilité. L’économie ? C’est sa responsabilité. Il était d’ailleurs comique -mais le mot, en raison de la gravité de la situation est impropre-, de voir des élus bouder des aides offertes par la France , à l’occasion du Pacte Nickel. Et même, -un comble-, expliquer à l’État leur mécontentement sur la façon de distribuer cet argent du contribuable français !
Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie est nue. Elle appelle à l’aide, comme à l’accoutumée, cet anonyme contribuable métropolitain. Mais ce serait une erreur que de se faire des